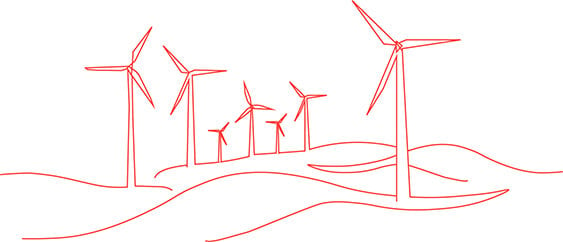La première génération de parcs éoliens au Canada atteindra bientôt la fin de sa durée de vie utile. Les producteurs indépendants doivent maintenant prendre des décisions importantes sur leur avenir. Ces éoliennes, construites pour la plupart avec une durée de vie répondant aux besoins d’ententes de production précises, produisent une énergie précieuse et plus importante que jamais pour les collectivités partout au pays.
Cette décision ne doit pas être prise à la légère. On doit y réfléchir en amont, car des répercussions économiques, sociales et environnementales sont en jeu. Sans compter les ressources énergétiques qui devront alimenter le réseau en cas de mise hors service du parc éolien.
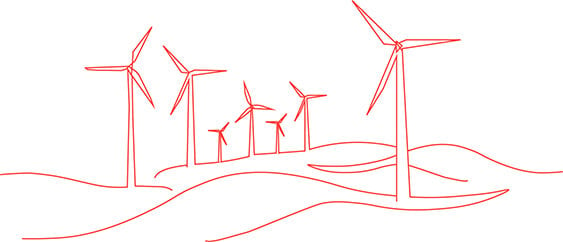
Le portrait actuel
Dans les premières années des parcs éoliens, les accords d’achat d’énergie étaient souvent conclus pour une durée de 20 ans. Il était donc logique de fixer la durée de vie théorique en fonction de ce calendrier.
Le premier parc éolien au Canada – une installation de 52 turbines – a vu le jour en 1993 à Pincher Creek, en Alberta. Dans les années et les décennies qui ont suivi, les autres provinces canadiennes ont emboîté le pas et construit des parcs éoliens qui étaient, en général, reliés au réseau énergétique local. Jusqu’à présent, peu de parcs éoliens ont été renouvelés ou ont obtenu une prolongation de leur accord d’achat d’énergie. Le développement de l’énergie éolienne ayant connu un essor important au début des années 2000, la question donc tombe à point.
Les parcs éoliens bien conçus, et c’est habituellement le cas, peuvent résister pendant toute leur durée de vie à des vents extrêmes et à de fortes tempêtes avec une marge de sécurité suffisante. Cependant, des événements naturels inattendus ont tout de même entraîné la défaillance de turbines. La foudre peut, par exemple, mettre hors service les composants électriques complexes de la turbine, et causer une défaillance de l’unité, ou même un incendie. Sans compter les défaillances et même l’effondrement de turbines, heureusement peu fréquentes, causées par un problème de conception.
Cela étant dit, là où des protocoles de conception et d’entretien appropriés ont été mis en œuvre, les échéanciers de 20 ans ont été respectés, permettant aux producteurs de satisfaire aux exigences définies dans les accords d’achat d’énergie initiaux. Un mauvais entretien entraîne rarement l’arrêt complet d’une turbine, mais peut réduire considérablement son fonctionnement, ce qui diminue la rentabilité du projet.
Évaluation du système existant
La fatigue est une sensation que nous ressentons après une longue journée. Tout ce que nous faisons contribue à vider notre réserve d’énergie et, à la fin de la journée, nous sommes épuisés. C’est un peu la même chose pour les composants mécaniques et structurels d’une éolienne. Le vent souffle dans toutes les directions, à différentes vitesses et intensités, parfois par rafales et avec violence. Chaque épisode de vent entraîne une légère détérioration des pales, de la chaîne dynamique, du rotor, de la tour et des fondations. Des méthodes nous permettent de calculer la détérioration créée par chaque épisode de vent prévu. Ces détériorations sont extrêmement faibles, mais en les additionnant, on obtient une somme non négligeable. L’estimation qui en résulte détermine la durée de vie restante d’une turbine donnée et de ses différents composants. C’est ce qu’on appelle la durée de vie en fatigue.
Cette évaluation est menée dans le respect des codes, normes et pratiques applicables les plus récents de l’industrie à la fin ou vers la fin de la durée de vie prévue du parc éolien. Elle permet d’évaluer à quel moment les composants présenteront des défaillances, la détérioration graduelle de la production du parc et le coût de la remise en état à différentes périodes.
Les éoliennes sont évaluées dans le cadre de travaux d’entretien réguliers et d’inspections rigoureuses des sites. Les techniciens, techniciennes, ingénieurs et ingénieures chevronnés peuvent identifier très tôt les signes de détérioration et informer les équipes des dépenses associées à la turbine qu’il faut prévoir, sans qu’il soit nécessaire d’estimer la durée de vie en fatigue. Cependant, un élément ne pourra jamais être inspecté dans son entièreté : les fondations.
Les spécialistes en techniques de fondations ont toujours regardé la tour de Pise d’un œil inquiet. Le processus décisionnel devrait débuter par un examen minutieux et une analyse des fondations. Si l’analyse révèle que les fondations ne peuvent porter une charge plus élevée, c’est un signal d’alarme qu’il ne faut pas négliger.
Dans les dernières décennies, l’industrie a grandement évolué. Les codes, les normes, les pratiques et les méthodes qui s’appliquent aujourd’hui sont très différents de ce qui était en vigueur il y a 20 ans. Une analyse récente des fondations est donc on ne peut plus justifiée.
À la suite de l’analyse, des données sur les fondations doivent être recueillies sur place. Cela peut se faire de plusieurs façons. On peut d’abord procéder par une inspection visuelle, un carottage ou des essais non destructifs sur les surfaces en béton, ou encore, par la mise en œuvre d’un programme de surveillance de l’état des structures plus robuste, comprenant l’instrumentation des tours et des fondations.
Utilisation de l’information
Une fois les inspections et les analyses terminées, les informations techniques peuvent être compilées, puis ajoutées aux informations existantes sur le projet (incitatifs économiques, politiques et financiers) afin de permettre une pleine compréhension de la valeur d’au moins trois options : laisser le système en l’état et continuer à le faire fonctionner, le restaurer ou le remplacer. Le parc éolien peut également être en fin de vie.
Après 20 ans d’exploitation, l’investissement initial dans un parc éolien devrait déjà être amorti. Si la durée de vie du système peut être prolongée sans trop d’efforts, le producteur et les copropriétaires peuvent réaliser des bénéfices directs considérables.
La rénovation du parc peut tout de même représenter une occasion financière intéressante pour le propriétaire. Si des composants doivent être remplacés, la prolongation de la durée de vie qui en résulte peut permettre de générer un rendement économique positif. Des avancées importantes en matière de technologie des turbines ont été réalisées depuis la première génération des parcs éoliens. On peut donc avancer des arguments économiques favorables à la modernisation d’un système et au remplacement de turbines, peu importe si la tour ou les fondations sont conservées. Ces travaux sont cependant tributaires de la nécessité de remplacer les tours ou les fondations. Certaines provinces offrent également des incitatifs fiscaux pour le remplacement de la technologie des turbines, ce qui peut également renforcer l’occasion financière.
Dans tous les cas, le rendement de l’investissement que les études d’ingénierie apporteront aux projets pourrait être important. Les études devront également convaincre les parties prenantes du projet (propriétaire, prêteur, assureur, services publics, collectivité) que, quelle que soit la voie suivie, le projet est sûr et ne présente pas un risque plus élevé par rapport aux autres parcs éoliens.
Le coût environnemental du démantèlement à terme
L’un des défis associés aux composants des anciennes technologies énergétiques propres est de s’assurer qu’une fois qu’ils ne servent plus, leur incidence sur l’environnement est minime.
Selon une fiche d’information de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable, environ 85 à 90 % des composants de turbines sont recyclables. L’acier, le cuivre et le béton utilisés dans le parc éolien peuvent être recyclés efficacement, car la demande pour ces types de produits est déjà bien établie.
Quant aux pales faites de matériaux composites, il n’est pas toujours possible d’en séparer les fibres, la résine époxyde et les autres composants fonctionnels, mais il existe plusieurs options durables pour les réutiliser.
La fibre de verre recyclée est peu recherchée, vu le prix très faible des matières premières, et peu offerte, puisque la plupart des pales au Canada n’ont pas encore atteint la fin de leur utilité primaire. Il existe néanmoins plusieurs méthodes de recyclage, dont le broyage pour obtenir des morceaux de tailles diverses, utilisés comme matériel de remplissage dans le béton. Certaines pales ont aussi été réutilisées dans des structures, comme des abris d’auto, des passerelles piétonnières et des aires de jeux.
Des organisations comme WindEurope (en anglais) collaborent avec des équipes de recherche de partout dans le monde pour trouver de nouvelles façons d’utiliser l’ensemble des composants d’éoliennes, contribuant ainsi à augmenter la quantité de matériaux pouvant être recyclés ou valorisés après le démantèlement d’une éolienne ou d’un parc éolien. La SADC de la région de Matane en collaboration avec l’Université de Sherbrooke travaille également sur un projet de R et D visant à intégrer entièrement les résidus de fibres des pales dans le béton en utilisant un procédé financièrement viable.
Peu importe les options choisies, il est important d’entamer les prochaines étapes du bon pied. Faites appel à des spécialistes qui peuvent vous conseiller sur ce qui est réalisable sur le plan technique et sur les pratiques réglementaires et de l’industrie nécessaires à la poursuite du fonctionnement, au démantèlement, à la remise en état ou à la reconstruction du parc éolien.