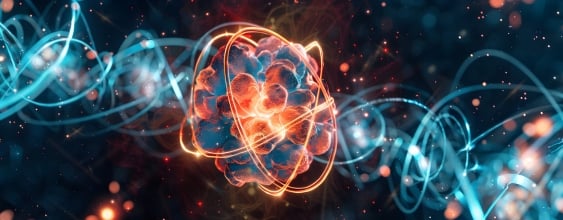Lorsqu’il est question de bâtiments, de ponts, de routes et de voies ferroviaires, tout comme d’hydroélectricité par pompage et d’énergie éolienne maritime, l’inconnu peut paralyser votre projet ou compromettre l’avenir. En effectuant dès que possible une investigation géotechnique intégrée et exhaustive des eaux souterraines et des milieux contaminés, vous pouvez éviter les dépassements budgétaires et les retards majeurs tout en atténuant les risques de fissures, de mouvement et d’usure prématurée de vos projets.
Nous avons discuté avec Cristian Loddo, directeur, Projets majeurs, et Mitchell McGinnis, gestionnaire de projet principal, à propos des mystères qui se cachent sous la surface.
La nature est complexe
C’est bien connu, les conditions du sol et souterraines sont imprévisibles, incertaines et changeantes, et peuvent varier grandement sur de courtes distances.
« Comme le disait si bien Karl von Terzaghi, l’un des fondateurs de l’ingénierie géotechnique, les produits de la nature sont toujours complexes », explique Cristian. « Puisque ce qui se trouve sous la surface est invisible et incertain, l’excavation révèle généralement un éventail de complexités et de problèmes.
L’environnement souterrain cache d’importants facteurs inconnus qui peuvent considérablement nuire aux coûts et à l’échéancier d’un projet. Lorsque la planification d’avant-projet laisse à désirer ou est réalisée de manière hâtive, c’est souvent à la livraison du projet qu’on le constate », précise-t-il.
L’investigation géotechnique, généralement composée du prélèvement d’échantillons aux fins d’essais en laboratoire et d’essais en fond de trou, permet de brosser un portrait clair des propriétés de la matière, des sollicitations in situ, des conditions des eaux souterraines ainsi que de la chimie du sol, des roches et des eaux souterraines. L’investigation explore également les tendances d’écoulement des eaux souterraines, étudie le potentiel de contamination et permet d’extrapoler les solutions de conception et les méthodes de construction requises pour faire face aux conditions anticipées.
« Avec ces données, les équipes de conception et de construction peuvent évaluer adéquatement les risques et proposer une conception et une méthode de construction suffisamment robustes et résilientes pour affronter non seulement les conditions attendues, mais également les variations potentielles de ces hypothèses », poursuit Cristian.
Anticiper les risques
Les risques associés aux conditions imprévues du sol – risques que l’on retrouve de plus en plus souvent – restent prioritaires pour de nombreux maîtres d’ouvrage et entrepreneurs impliqués dans la conception et la construction des projets d’infrastructure.
« Il est maintenant plus risqué qu’avant d’élever une structure hors du sol. En effet, de nombreux projets d’infrastructure sont développés dans des endroits qui rendent l’accès ou l’aménagement plus difficile », affirme Mitchell. « C’est peut-être parce que les endroits plus faciles ont déjà tous été aménagés, que le projet constitue le dernier élément complexe d’une solution plus vaste, ou qu’il s’agit d’une modification ou d’une mise à jour à une infrastructure désuète existante. »
Il poursuit en soulignant que l’on suppose souvent à tort qu’un fonds de réserve pourra suffire pour couvrir le risque lié au sol et qu’il offrira le niveau de protection requis contre les incertitudes.
« Si l’on se fie au passé, il est très difficile d’évaluer et d’attribuer un fonds de réserve adéquat pour les risques liés au sol sans d’abord avoir effectué une investigation géotechnique exhaustive afin de relever et de décrire les conditions attendues et leurs variations potentielles. » Selon Mitchell, c’est également le cas pour la planification de l’excavation et de la méthode utilisée pour la construction.
« Pour prévenir efficacement ces risques, il est extrêmement important de planifier et d’effectuer une investigation géotechnique échelonnée, et d’élaborer simultanément un modèle géotechnique des sols », précise Mitchell.
« En élaborant un modèle des sols et en le mettant à jour au rythme de l’investigation, il est possible de relever et de cibler les lacunes en matière de connaissances et de prendre des décisions techniques éclairées avant le début de la construction. »
Agir rapidement et échelonner l’investigation géotechnique pour en optimiser la valeur
Il est naturel et fréquent pour les promoteurs de projet de chercher à mettre les projets en branle dès que possible. Toutefois, il est judicieux de prendre le temps de planifier, d’exécuter et d’interpréter correctement une investigation géotechnique intégrée et échelonnée pour réduire les pertes de temps subséquentes causées par les imprévus. Cet investissement contribue également à réduire le risque de dépassement des coûts à la livraison du projet.
Le diagramme suivant démontre comment varie la capacité d’influencer les risques et les coûts associés selon les différentes étapes du projet, de la planification à la mise en service, en passant par la conception et la construction. On constate clairement que la possibilité d’intervenir diminue et que les coûts augmentent avec la progression du cycle de vie du projet. Il est donc préférable d’effectuer le plus d’investigations géotechniques détaillées possible sans tarder.

Adapté de Gibson et Hamilton (1994). Analysis of pre-project planning effort and success variables for capital facility projects. Construction Industry Institute, source document 105
Mitchell précise que cette approche commence à l’étape de faisabilité, par une étude documentaire rigoureuse suivie par des investigations initiales sur place pour noter chaque caractéristique clé et risque liés au sol.
« Les investigations géotechniques doivent suivre la progression du projet – de la planification à la livraison – en devenant de plus en plus détaillées et en ciblant des zones d’incertitude ou de complexité », ajoute-t-il. « Après chacune des étapes d’investigation, le modèle géotechnique des sols, le registre des risques du projet et les stratégies d’atténuation des risques proposées doivent être mis à jour pour refléter les nouvelles données obtenues. » Cette approche permet d’apprendre de chacune des étapes de l’investigation et de mettre à jour progressivement la portée de l’investigation.
Il estime que les mises à jour documentées doivent inclure les mesures de gestion et d’atténuation des risques relevés selon les solutions de conception adoptées et la méthode de construction proposée.
« L’omission d’une seule étape, prévient-il, viendra annuler les avantages de l’atténuation des risques sur toute la durée de vie du projet. »
Approches pratiques échelonnées pour favoriser la réussite des projets
Cristian explique que WSP a réussi à mettre en place une approche échelonnée dans le cadre de nombreux projets. On parle notamment du projet Regional Rail Link, du métro de Melbourne, du projet de ligne de transport Sydney Metro City and Southwest, du projet Western Harbour Tunnel et Beaches Link ainsi que du projet Suburban Rail Loop.
« En étroite collaboration avec nos clients, nous avons démontré la flexibilité requise pour adapter proactivement et rapidement les portées de nos investigations afin de détecter et d’aborder sans tarder les risques émergents, et de rehausser les chances de réussite de nos projets », dit-il.
En plus d’adopter une approche échelonnée, les investigations géotechniques bénéficieront de l’effort cohésif, collaboratif et intégré d’une expertise diversifiée.
Mitchell ajoute que « lorsque les projets tirent parti de l’expertise collective d’un éventail de professionnels, on obtient une vaste gamme de stratégies et de solutions d’investigation permettant de mieux comprendre les conditions attendues et les défis potentiels liés au sol. »
Pour en savoir plus, communiquez avec Cristian Loddo, directeur, Projets majeurs, ou Mitchell McGinnis, gestionnaire de projet principal, Géotechnique et tunnels.