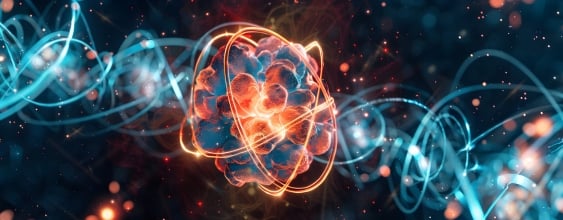Si la décarbonation peut intuitivement sembler être bonne pour d’autres aspects du développement durable, rien n’est garanti. Une approche de conception intégrée sera nécessaire pour trouver un bon équilibre entre différents objectifs concurrents et parfois contradictoires. Plus d’air frais et une meilleure filtration dans des immeubles « sains » entraînent, par exemple, une consommation énergétique accrue. Des énergies renouvelables produites sur place peuvent accroître la résilience aux phénomènes extrêmes et aux pannes de réseau, mais l’ajout de génératrices au diesel aussi.
« Ce n’est définitivement pas automatique, souligne Joshua Radoff, vice-président principal chez WSP au Colorado. Certaines choses sont bonnes en soi, comme l’élimination de la combustion, et une conception passive vraiment efficace nécessitera d’accorder plus d’attention à la ventilation et l’apport d’air frais. Mais ça ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de l’aménagement paysager, des espaces publics ou de la connectivité. La prise en considération de ces éléments doit être explicite; sinon, ils peuvent facilement être laissés de côté. Un accent mis exclusivement sur la carboneutralité pourrait permettre de cocher toutes les cases, sans toutefois produire aucun autre avantage. »
Les mesures de compensation en sont un excellent exemple, puisqu’elles peuvent ou non produire un éventail d’avantages au-delà de la simple réduction des émissions de carbone. « Il pourrait simplement s’agir d’un parc éolien au Texas qui allait être aménagé de toute manière, explique Radoff. C’est bénéfique, mais ça n’aide certainement pas votre collectivité. » Des entreprises peuvent consciemment décider d’acheter des crédits qui s’alignent avec leur mission et leurs valeurs, suggère Tim Parker, directeur développement durable chez WSP à Sydney. « L’engagement des peuples autochtones est un sujet très important en Australie, et l’obtention de crédits de biodiversité par l’accroissement des milieux naturels dans les communautés autochtones est une mesure de compensation beaucoup plus tangible et valable que l’achat d’un parc éolien dans un autre pays, dit-il. Ça coûte probablement plus cher, mais c’est aux organisations de soupeser tout ça. »
C’est le choix qu’a fait la coopérative de supermarchés danoise Coop avec son programme « La forêt des gens » (Folkeskove) qui vise le reboisement de mille hectares de forêt à la grandeur du pays d’ici 2030. Il serait plus facile pour Coop de respecter ses exigences de compensation dans des pays où la terre et la main-d’œuvre sont moins chères, mais l’approche qu’a retenue l’entreprise démontre une connexion à ses clients et permet à ces derniers de profiter de coavantages comme l’accès à des milieux naturels et une plus grande biodiversité. « Si le seul intérêt de Coop était d’être carboneutre, il serait beaucoup plus efficace d’aménager de nouvelles forêts dans les Tropiques, affirme Allan Bechsgaard, directeur forêts chez DDH, qui gère la terre au nom de Coop. Mais l’entreprise trouve qu’un projet local offre une valeur ajoutée. Il fournit des possibilités de loisirs pour les habitants de la région et pour ses propres employés, et Coop peut démontrer qu’elle redonne à la société. » Il ajoute que DDH, la plus importante société danoise d’aménagement forestier, observe un intérêt croissant pour de telles initiatives forestières au pays, en particulier par des coopératives comme la chaîne Coop, et des organisations bien connectées aux collectivités locales.
Il peut y avoir une limite aux avantages supplémentaires que les projets carboneutres peuvent produire avant que l’investissement devienne non viable. La priorisation peut alors s’avérer utile, et c’est ce que l’équipe de Joshua Radoff a aidé la ville de Boulder à faire pour un projet de logement social carboneutre. Pour ce projet, la priorité était l’abordabilité, mais il pourrait en être tout autrement pour un siège d’entreprise. Une autre solution consiste à élargir la portée, en obtenant par exemple du financement pour des éléments supplémentaires comme des installations photovoltaïques ou éoliennes, dont les coûts peuvent généralement être récupérés sur le long terme. Une troisième solution consiste à trouver des partenaires qui peuvent aussi bénéficier du projet, tels que des services publics. Pour un projet de 1,3 million de m2 au centre-ville de Denver, WSP a déterminé si les bâtiments pouvaient être chauffés par la chaleur résiduelle de l’épuration des eaux d’égout, permettant ainsi d’éviter la construction, au coût de plusieurs millions de dollars, d’installations de refroidissement. « Nous avons constaté que l’avantage serait marginal pour le projet puisqu’il ne s’agit que de déplacer des gaz, mais si on inclut l’avantage pour le gouvernement de ne pas avoir à construire de telles installations dispendieuses à l’avenir, tout le monde y gagne. » On pourrait en dire autant de l’électrification d’une flotte d’autobus, ajoute-t-il, s’il était possible de quantifier les avantages pour le système de santé local d’une baisse de l’incidence des maladies respiratoires. « Si des partenaires peuvent aussi profiter des coavantages, ça peut en valoir le coût. »